Dans les cosmogonies antiques et chrétiennes, le chaos fait référence à l’état du monde avant qu’il ne soit organisé par les dieux ou par Dieu. Dans le cas de la chrétienté, le Verbe divin ordonne sa Création à partir du Chaos, l’un et l’autre devenant pour ainsi dire antithétiques. La matière attend que l’esprit créateur l’ordonne. Selon Thomas d’Aquin (XIIIe siècle), l’image n’est ainsi qu’une imitation et la beauté des formes est le reflet de l’invisible beauté de Dieu. Or, de cette séparation idéaliste de l’image et de la forme, de ce dualisme essentialiste, Bataille ne veut plus.
A la suite de Nietzsche, Georges Bataille ne trace plus de frontières entre le biologique et l’esthétique, la vie étant une question de forme. Contre l’esthétique classique et l’autonomie des Beaux-Arts, Bataille relativise les valeurs occidentales et met en avant une esthétique de l’informe.
Si la remise en valeur de Dionysos [1] date du Romantisme allemand (rôle des barbares), l’esthétique à laquelle le XIXe siècle se rattache est le schéma métaphysique de l’incarnation par laquelle le verbe s’est fait chair, conception tant romantique que hégelienne. Il n’est pas nécessaire de rappeler combien Nietzsche contribua à repenser, sous les noms d’apollinien et de dionysiaque, les rapports de l’art et du réel. Ce réel que Hegel prétendait ramener à la mesure de la Raison et de l’Esprit, Nietzsche l’envisageait plutôt ainsi : « La condition générale du monde est, au contraire, de toute éternité, le chaos, non par l’absence d’une nécessité, mais au sens d’un manque d’ordre, de structure, de forme, de beauté, de sagesse. » [2] Or, pour en venir à la période qui retient notre attention ici, Georges Bataille estima que le surréalisme, sous la houlette d’André Breton, restait bien trop hégelien et trahissait le réel « dans son immédiateté pour un surréel rêvé sur la base d’une élévation d’esprit » [3]. Il fonda alors dès 1929 une revue anti-surréaliste, Documents, à laquelle contribueront des peintres, des écrivains, des historiens d’art et des ethnologues en quête des « traces d’un refoulé sur lequel se sont édifiées la culture et la rationalité occidentales. » [4] La compagnie d’ethnologues le conduisit à s’intéresser aux primitifs chez qui les dichotomies entre nature et culture, animalité et humanité promettaient d’être dégagées des problématiques humanistes.
Mais l’événement survient en 1940 lorsque la grotte de Lascaux révèle les trésors artistiques que son obscurité tenait celés depuis deux cent siècles. Comme le rappelle Vincent Teixeira, Georges Bataille écrivit peu sur l’art avant la création de la revue Critique en 1946. Jusqu’en 1953, année où il commence à travailler sur Lascaux, il publie plusieurs articles sur l’art, essentiellement dans Critique, dont le propos général est de
« réorienter notre vision de l’art sur un sentiment athéologique du sacré et sur le dépassement de la raison, la transgression des limites. L’art représente une révolte contre le monde profane du travail, dominé par le projet et l’utilité. Dans ce ‘règne de la chose’, des brèches s’ouvrent, passagères, vers l’intimité perdue : l’art comme la poésie, le rire, les larmes, l’ivresse, le jeu ou l’érotisme, crée ces états d’émotion intense. » [5]
Lorsqu’il se met à travailler sur ce qui sera un des premiers ouvrages de valeur relatifs à cette grotte : Lascaux ou la naissance de l’art, Georges Bataille a précisément l’intention de saisir à son origine, pour la mieux déployer, une création artistique dont les fresques pariétales de Lascaux prouvent qu’elle n’obéit à aucun progrès. Fernand Windels avait publié en 1948 un Lascaux, ‘Chapelle Sixtine’ de la Préhistoire et l’abbé Breuil une somme intitulée Quatre cent siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées de l’Âge du Renne (1952). Georges Bataille est ainsi tributaire des travaux de ce dernier pour ce qui en est des informations d’ordre paléontologiques et paléo-ethnographiques. Cependant, son approche est tout à fait personnelle et Lascaux se révèlera un moment capital de son œuvre.
L’authenticité et surtout l’ancienneté de l’art rupestre et pariétal furent sujettes à caution sinon à plaisanterie jusqu’au début du XXe siècle. Malgré Lascaux, ou peut-être à cause de la beauté et de la qualité d’exécution de ses fresques, le scepticisme fut grand, comme en 1879 après la découverte de la caverne d’Altamira. A l’époque, on parla d’un complot des jésuites espagnols qui « auraient fait éxécuter un faux en vue de compromettre les préhistoriens. » [6] En 1952, André Breton lui-même s’illustra en provoquant un incident pour lequel il fut condamné. Dans la grotte de Pech-Merle, près de Cabreret (Lot), le surréaliste voulut en effet juger de la fraîcheur de la peinture en y passant le doigt. L’incident incita la Société des Gens de Lettres à diligenter une enquête sur l’authenticité des cavernes. L’abbé Breuil s’en chargea.
Albert Skira rappelle ainsi que c’est Georges Bataille qui lui fit la proposition de cet ouvrage. Il y vit une introduction naturelle à sa collection sur « Les Grands Siècles de la Peinture ». « Mais ces peintures préhistoriques, écrit Skira, témoignage de l’art à ses origines, se révèlent étrangement proches de la sensibilité moderne ; à les considérer, on dirait que le temps n’existe pas. » [7] Ce sont en effet deux éléments caractéristiques de l’approche bataillienne. D’une part, il considère que ces peintures sont « le premier signe sensible qui nous soit parvenu de l’homme et de l’art » [8]. D’autre part, son intérêt pour l’origine, qu’il avait déjà manifesté dans Documents à l’endroit des primitifs pourrait sembler en contradiction avec la défiance de Nietzsche pour l’origine lorsqu’il dit : « Avec l’intelligence de l’origine l’insignifiance de l’origine augmente » [9].
Mais Bataille ne fait pas partie des ci-devant qui exaltent l’origine parce qu’ils espèrent y trouver la légitimité de leurs analyses. Ils ne font que chercher un trésor sous un arc-en-ciel. Georges Bataille se réfère à cette « aurore de l’espèce humaine » [10], comme il dit, parce qu’il sent combien l’homme de Lascaux communique « avec la lointaine postérité que l’humanité présente est pour lui » [11]. S’il exalte l’homme de Lascaux, ce n’est pas pour rabaisser l’humanité présente mais pour mieux la comprendre.
« C’est de l’ « homme de Lascaux » qu’à coup sûr et la première fois, nous pouvons dire enfin que, faisant œuvre d’art, il nous ressemblait, qu’évidemment, c’était notre semblable. [...] Nous devons [...] souligner qu’il témoigna d’une vertu décisive, d’une vertu créatrice, qui n’est plus nécessaire aujourd’hui.
[...] L’ « homme de Lascaux » créa de rien ce monde de l’art, où commence la communication des esprits. [...] A Lascaux, ce qui, dans la profondeur de la terre, nous égare et nous transfigure est la vision du plus lointain. Ce message est au surplus aggravé par une étrangeté inhumaine. Nous voyons à Lascaux une sorte de ronde, une cavalcade animale, se poursuivant sur les parois. Mais une telle animalité n’en est pas moins le premier signe pour nous, le signe aveugle, et pourtant le signe sensible de notre présence dans l’univers. » [12]
A l’encontre des visions judéo-chrétiennes de l’homme, pour lesquelles il est inconcevable de prendre en bonne part, même chez Socrate, la notion de démon, Georges Bataille cherche à comprendre comment l’humain est sorti de l’animal. Les larmes d’Eros (1962) abordera d’ailleurs dès ses premières pages cette question du diabolique, défini comme « coïncidence de la mort et de l’érotisme ». [13] Ainsi Bataille établit-il un lien entre l’art, l’érotisme et le processus consistant à devenir humain.
Pas plus que nous qui avons cependant beaucoup plus de connaissances sur la préhistoire qu’il n’en disposait il y a un demi-siècle, Georges Bataille n’ignorait que les artefacts humains sont bien antérieurs à Lascaux. La principale différence entre Bataille philosophe et les préhistoriens est la réticence de ces derniers à envisager le phénomène humain, pour reprendre néanmoins l’expression d’un des plus célèbres d’entre eux, Teilhard de Chardin, dans toute sa dimension. Il n’est pas seulement question d’extrapolations auxquelles le sérieux scientifique se refuse, mais de la façon d’appréhender l’homme. Ainsi pour Marcel Otte, auteur de Les origines de la pensée (2001) :
« Un processus rétroactif caractérise l’évolution de l’homme : une fois libéré des nécessités biologiques élémentaires, la pensée a poussé l’évolution humaine dans la direction qui lui convenait, particulièrement dans la relation entretenue entre la main et le cerveau. » [14]
Si bien que pour lui « l’outil fit l’homme » [15]. La culture est considérée comme la résultante et le moteur des évolutions biologiques, mais l’art est traité par Marcel Otte, de façon symptomatique, en à peine deux pages, où il reprend les analyses structurales d’André Leroi-Gourhan selon qui les cavernes offrent une représentation narrative des mythes du groupe. Marcel Otte estime que l’art paléolithique, « moins qu’un reflet de la pensée [...] a produit une sensibilité et a guidé les sociétés préhistoriques successives dans leurs croyances, leurs mythes et leurs valeurs. » [16] Finalement, l’art du paléolithique supérieur caractérisé par l’image se réduit selon le préhistorien, à « l’évocation d’une réalité virtuelle, détachée [...] de la nature et possédant sa propre histoire. » [17] Ce qui revient à séparer l’esthétique du biologique, les Paléolithiques préparant lointainement l’autonomisation de l’esthétique par Kant !
L’interprétation structurale pas plus que l’interprétation idéalisante ne permettent de rendre justice à l’émotion qui saisit le spectateur. Ainsi Georges Bataille qualifie-t-il ces peintures de Lascaux de miraculeuses :
« Ces peintures, devant nous, sont miraculeuses, elles nous communiquent une émotion forte et intime. Mais elles sont d’autant plus inintelligibles. On nous dit de les rapporter aux incantations de chasseurs avides de tuer le gibier dont ils vivaient, mais ces figures nous émeuvent, tandis que cette avidité nous laisse indifférents. Si bien que cette beauté incomparable et la sympathie qu’elle éveille en nous laissent péniblement suspendu. » [18]
Bataille ne réfute pas l’interprétation chamanistique dont la validité reste sujette à polémique de nos jours encore à propos de la grotte Chauvet ; il constate simplement que l’émotion est étrangère au calcul. Lascaux répond selon lui à notre aspiration à l’émerveillement : « à Lascaux, l’humanité juvénile, la première fois, mesura l’étendue de sa richesse [...], c’est-à-dire du pouvoir qu’elle avait d’atteindre l’inespéré, le merveilleux. » [19]
Certes, l’humanité, bien avant la naissance de l’art, avait senti son pouvoir sur la nature grâce à l’outil, développé et perfectionné au cours des 2 à 3 derniers millions d’années, mais aussi grâce à la maîtrise du feu, il y a 1.6 million d’années. Pourtant, aux yeux de Georges Bataille, cela ne suffit pas à faire de ces anthropoïdes des humains, d’abord parce qu’ils ne comprennent pas la mort, ce qui est vrai avant cent mille ans environ. Pour Marcel Otte, « l’apparition des sépultures marque un véritable pivot » situé en plein milieu néandertalien, « les dépôts funéraires, souvent des fétiches animaux (ramures, ossements), rappellent cette affinité avec la nature dont l’homme s’est extrait et s’est rendu maître, jusque dans les symboles de la mort. » [20] Conclusion dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle paraît bien hâtive, tant la maîtrise de la nature peut sembler alors dérisoire et tant la sortie hors de l’animalité reste relative. C’est du moins le sentiment de Georges Bataille.
Pour lui, les Néandertaliens se séparent progressivement de la bête grâce à la comparaison du corps humain et de l’outil qui, lui, perdure. Ils se sont ouverts à la pensée de la mort qui donne alors un autre relief aux objets et à la vie humaine : certains objets comme les restes humains deviennent sacrés, un interdit les enveloppe. Et ce fait est évidemment d’importance. Pendant des centaines de milliers d’années, l’homme s’est fait par le travail, grâce à l’outil :
« C’est par le travail que l’animal devint humain. Le travail avant tout fut le fondement de la connaissance et de la raison. La fabrication des outils ou des armes fut le point de départ de ces premiers raisonnements qui humanisèrent l’animal que nous étions. L’homme, façonnant la matière, sut l’adapter à la fin qu’il lui assignait. Mais cette opération ne changea pas seulement la pierre [...] L’homme se changea lui-même : c’est évidemment le travail qui de lui fit l’être humain, l’animal raisonnable que nous sommes. » [21]
Le relief que Bataille donne à la question de l’outil rappelle celui que Heidegger donna à la question de la technique dès Sein und Zeit (1927) où il affirmait que « l’outil est essentiellement ‘quelque chose pour’ » [22]. Mais contrairement à l’Allemand qui s’est intéressé au moment grec, Bataille pose en contrepoint au miracle grec le ‘miracle de Lascaux’ : « la Grèce elle aussi nous donne un sentiment de miracle, mais la lumière qui en émane est celle du jour » [23], écrit Bataille. Celle de Lascaux est, elle, intimement liée à l’obscurité souterraine. Alors qu’Heidegger estime que l’homme est homme parce que la clairière de l’Être s’est ouverte à lui dans le langage, Bataille estime que l’invention de l’art par l’espèce qui succéda à l’Homo faber, c’est-à-dire l’Homo sapiens, est, après le travail, l’événement principal ayant marqué le cours du monde et permis « le passage de la bête humaine à l’être délié que nous sommes » [24]. Leur différence d’appréciation n’est pas anodine :
« La naissance de l’art doit elle-même être rapportée à l’existence préalable de l’outillage. Non seulement, l’art supposa la possession d’outils et l’habileté acquise en les fabriquant, ou en les maniant, mais il a, par rapport à l’activité utilitaire, la valeur d’une opposition : c’est une protestation contre un monde qui existait, mais sans lequel la protestation elle-même n’aurait pu prendre corps.
Ce que l’art est tout d’abord, et ce qu’il demeure avant tout, est un jeu. Tandis que l’outillage est le principe du travail. Déterminer le sens de Lascaux, j’entends de l’époque dont Lascaux est l’aboutissement, est apercevoir le passage du monde du travail au monde du jeu, qui est en même temps le passage de l’Homo faber à l’Homo sapiens, physiquement de l’ébauche à l’être achevé. » [25]
Ce passage graduel dont Lascaux est le témoin est celui d’un monde ordonné par le travail, c’est-à-dire régi par la recherche d’une fin et d’un gain, à la découverte que ce monde pouvait être troublé par deux choses : la mort et la sexualité qui toutes deux révèlent notre animalité. Si bien que Lascaux est pour Georges Bataille ce monde qu’ordonna le sentiment de l’interdit :
« Ce qui trouble un ordre des choses essentiel au travail, ce qui ne peut être homogène au monde des objets stables et distincts, la vie qui se dérobe ou qui surgit, dut être assez vite situé à part, tenu suivant les cas pour néfaste, pour dérangeant, pour sacré. » [26]

Accordant crédit à l’interprétation chamanistique des peintures, Bataille considère qu’en elles sont présentes une part de jeu (celui de l’art), et une part de calcul intéressé (celui de la magie). Si l’objet de la magie est de se concilier les faveurs de la nature pour obtenir une bonne chasse, l’objet de l’art est « la création d’une réalité sensible, modifiant le monde dans le sens d’une réponse au désir de prodige, impliqué dans l’essence de l’être humain. » [27] Ce désir de prodige ne peut être comblé par le monde du travail. La ‘licorne’ (ci-dessus, doc.1) de Lascaux par exemple, ainsi nommée par défaut, qui n’a rien de naturaliste et qui rappelle d’autres animaux non-identifiés de la grotte Chauvet notamment, ne peut correspondre à aucune volonté de chasse heureuse. Elle est, dit Bataille, « la part de la fantaisie, la part du rêve, que n’ont déterminée ni la faim ni le monde réel. » [28] Cette peinture située à l’entrée de la grotte, participe à la « composition mouvementée qu’ordonnent et magnifient » les taureaux, « elle l’amplifie, la complète et l’enrichit d’un élément de bizarrerie, [...et] est d’autant plus divine qu’elle est inintelligible, étrangère à tout. » [29].
Reprenant la terminologie de Rudolf Otto dont il eut connaissance en 1929, Bataille considère le ‘divin’ ou le ‘sacré’ comme quelque chose d’ambigu, « à la fois saint et maudit, sacer, pur et impur, blanc et noir, fascinans et tremendum » ; « le ‘sacré’ est le ‘tout autre’, séparé, hétérogène », et « cette ‘hétérologie’ comprend les formes les plus nobles comme les plus basses. Jeu cruel, l’art a le pouvoir d’engendrer une altérité folle, belle, laide ou effrayante. » [30]
Ainsi, puisant ses informations chez l’abbé Breuil qui en fit un relevé dans les cavernes des Trois Frères (Ariège, ci-dessous, doc.2),

Bataille tire-t-il du constat fait par d’autres de la présence d’êtres fantastiques, la conclusion que la relation à l’animal est problématique. Bataille en fait d’ailleurs un élément central de son explication de l’art pariétal qui « ébranle le monde asujetti à l’utilité et régi par des valeurs qui camouflent et refoulent la violence sacrée » de l’animal : « il crée, écrit Vincent Teixeira, de nouvelles possibilités d’ « inquiétante étrangeté » [31]. L’exactitude et la beauté naturalistes des fresques animales de Lascaux par exemple, ou de celles de Chauvet que Bataille ne pouvait connaître, contraste singulièrement avec la représentation de l’homme :
« Ce qui nous fige en un long étonnement est que l’effacement de l’homme devant l’animal - et de l’homme justement humain - est le plus grand que nous puissions imaginer. Le fait que l’animal représenté était la proie et la nourriture ne change pas le sens de cette humilité. L’homme de l’Age du renne nous laissait de l’animal une image à la fois prestigieuse et fidèle, mais, dans la mesure où il s’est lui-même représenté, le plus souvent, il dissimulait ses traits sous le masque de l’animal. Il disposait jusqu’à la virtuosité des ressources du dessin, mais il dédaignait son propre visage : s’il avouait la forme humaine, il la cachait dans le même instant ; il se donnait à ce moment la tête de l’animal. Comme s’il avait honte de son visage et que, voulant se désigner, il dût en même temps se donner le masque d’un autre. » [32]
Si chaque visage humain est bien « une formation de museau qui n‘a pas eu lieu » [33], pourquoi en effet, à cette époque, l’être humain remplace-t-il systématiquement son visage par un masque animal ? L’hypothèse de Georges Bataille est que « le passage de l’animal à l’homme fut d’abord le reniement que fait l’homme à l’animalité » [34]. Maintenant au contraire, nous tenons pour essentiel ce qui nous distingue de l’animal et ce qui rappelle l’animalité subsistante « est objet d’horreur et suscite un mouvement analogue à celui de l’interdit. » [35] Si la réalisation de ces peintures répondait, dans son aspect magique, à un travail, elle devint en même temps un jeu relatif aux interdits qui permettaient la pérennité du monde du travail. Ce jeu est un jeu transgressif où interviennent l’angoisse de la mort et celle de la sexualité, éléments qui sont précisément la marque de notre animalité et que l’homme aborda différemment.
En effet, en sortant progressivement de l’animalité dans laquelle la sexualité est d’ordre instinctif, l’homme qui avait accédé par le travail à la conscience de la fin poursuivie, assigna à la sexualité cette fin qu’est la recherche du plaisir. Certes, l’accouplement en vue de la reproduction restait un gain dans le monde ordonné par le travail, si bien que l’érotisme, en tant que recherche de l’extase, devait être repoussé dans le domaine de l’interdit. Mais alors que le résultat du travail est le gain, « le résultat de l’érotisme, écrit Bataille, envisagé dans la perspective du désir, indépendamment de la naissance possible d’un enfant, c’est une perte, à laquelle répond l’expression paradoxalement valable de ‘petite mort’. » [36]
Bataille n’a pas manqué de constater que les premières représentations humaines sont toujours sexuelles. Les Vénus sont bien sûr célèbres, qui ont longtemps passé pour des allégories de la fertilité (Lespugue, ci-dessous, doc.3),
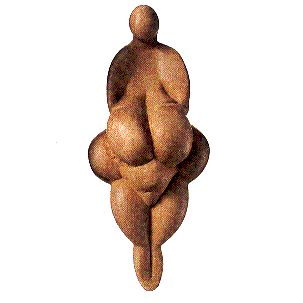
mais ces représentations canoniques sont le masque de chair cachant des scènes plus ambiguës. Que penser en effet de ce ‘calembour plastique’ d’un nu de femme prenant une allure phallique (ci-dessous, doc.4),

ou de ce déjà fameux ‘panneau du Sorcier’ récemment découvert en Ardèche dans la grotte Chauvet ? Cette dernière offre en effet le spectacle d’un étrange assemblage entre un corps féminin et un bison (ci-dessous, doc.5). Non seulement cela laisse supposer que les représentations féminines ne sont pas nécessairement des figurations de la déesse-mère, mais aussi que ces êtres composites qui ont une part humaine féminine évoquent autre chose qu’un culte de la fertilité.

Pour s’en convaincre, il suffit de constater la fréquence des êtres composites plus ou moins ithyphalliques : comme cet homme-bison de la caverne des Trois Frères qui semble répondre à la femme bison de la grotte Chauvet (ci-dessous à droite, doc.6) ou cet autre bison à jambes postérieures humaines (ci-dessous à gauche, doc.7) de la caverne des Trois Frères.


Mais l’allure peut se faire plus nettement humaine (grotte de Gourdan, ci-dessous à droite, doc.8) le visage reste cependant proche du museau.

Comme Georges Bataille l’a noté, la représentation humaine escamote toujours le visage, dont nous sommes fiers, et exhibe ce qui pour nous est cause de gêne : le sexe et la mort. On trouve ainsi gravée à Altamira ce personnage ithyphallique dont l’allure est incontestablement humaine, mais dont le visage est animal (ci-contre, à gauche, doc.9).

Mais ces gravures sont moins connues que celle de la célèbre ‘scène du puits’ à Lascaux dont l’interprétation a causé tant de débats où les non-dits étaient souvent plus riches de sens que les affirmations souvent prudentes et circonspectes des préhistoriens et anthropologues.
Cette scène (ci-dessous, doc.10) tient son nom du fait qu’elle a été peinte dans le lieu le plus reculé et le plus difficile d’accès de la grotte de Lascaux, à tel point qu’on peut se demander si elle n’était pas tenue secrète. Bataille constate la différence entre l’exécution du bison et du rhinocéros, « figuration du réel à laquelle convient le nom de réalisme intellectuel » et celle de l’homme dont le dessin est « outrancièrement maladroit, comparable aux simplifications des enfants » [37].

L’hypothèse de l’abbé Breuil est qu’il s’agirait de la commémoration d’un accident. Celle de l’anthropologue allemand Kirchner se base sur un rapprochement avec un sacrifice yakoute : à ce titre, l’homme en extase représenterait un chamane coiffé d’un masque d’oiseau, qui expierait le meurtre de l’animal chassé. Mais ces deux hypothèses ont pour Georges Bataille le défaut de laiser de côté soit le rhinocéros, soit l’oiseau et de s’appuyer sur « le caractère invraisemblable de l’interprétation du bison éventré comme un sacrifice » [38].
D’ouvrage en ouvrage, c’est-à-dire de Lascaux (1955), puis L’Erotisme (1957) jusqu’aux Larmes d’Eros (1961) enfin, Bataille revient inlassablement sur cette scène mystérieuse, et s’enhardit dans son explication en la rattachant explicitement à l’érotisme. Comme nous l’avons vu, pour Bataille l’érotisme détourne l’homme de l’univers du travail qu’il s’est construit, univers où les interdits ont le rôle de garde-fous contre la puissance dissolvante du chaos. La figuration de ces interdits relatifs à l’animalité hors de laquelle l’être humain tentait de se dégager, voilà ce que la scène du puits offre à voir. Contrairement à l’animal pour qui la puissance du désir ne pose pas problème, selon Bataille, « la violence exaspérée, la violence désespérée de l’érotisme » nous atteind « du fait que nous sommes humains, et que nous vivons dans la sombre perspective de la mort » [39].
Tout en ne prétendant pas détenir l’explication de cette scène dont il souligne le caractère peut-être inconnaissable, l’explication de Bataille grâce à l’hypothèse d’un univers humain du travail ordonné par des interdits permet de trouver à l’hypothèse chamanistique une source autre que vaguement métaphysique. En effet, se référant à Malinowski, Bataille écrit :
« L’homme pouvait agir sur la nature, il pouvait la changer, mais il ne pouvait faire que la chance ne disposât finalement de la réussite du chasseur. La chance dépendait d’un monde plus puissant que celui du travail et de la technique, d’un monde fermé à l’homme dans l’attitude du travail [...]. » [40]
L’homme imagina alors qu’il pouvait, mais d’une autre façon, agir sur les puissances de ce monde. Si la magie est bien, comme le travail, la recherche d’un résultat intéressé, elle l’est dans la mesure où l’homme reconnaît son impuissance :
« L’opération magique [...] témoigne de l’obstination dans la recherche du résultat, mais elle annonce un primat dans l’ordre des valeurs : celui du sacré sur le profane, des désordres du désir sur le calcul de la raison, de la chance sur l’humble mérite et de la fin sur les moyens. L’homme du travail et de la technique se réduit à tout prendre au moyen, dont l’être non assujetti au travail, dont l’être animal, sans technique, est la fin. » [41]
Si bien que le monde animal dut être considéré comme sacré et supérieur au monde humain. La non figuration des visages humains, le schématisme des corps s’explique alors par contraste avec la beauté merveilleuse des animaux représentés comme un signe, selon Bataille, du peu d’estime que les humains accordaient à leur travail en regard de la force incomparable des animaux. Le « dieu cornu » (doc. 2) témoigne ainsi du fait que l’animal « se place au niveau des dieux et des rois » [42]. Par cette représentation, l’homme cherche à nier son humanité en ce qu’elle est enchaînée au travail et à l’efficacité ; le peintre cherche à « nier l’homme au bénéfice d’un élément divin et impersonnel, lié à l’animal qui ne raisonne pas et ne travaille pas. » [43]
Le sens ultime et fondamental que Georges Bataille attribue ainsi à l’art pariétal est l’expression de l’émotion d’un être en métamorphose qui mesure tout ce qu’il perd à devenir humain :
« Aussi bien, s’ils le pouvaient, se dérobaient-ils à la régularité fastidieuse de l’ordre humain : ils revenaient à ce monde de la sauvagerie, de la nuit, de la bestialité ensorcelante ; ils le figuraient avec ferveur, dans l’angoisse, inclinant à l’oubli, pour un temps, de ce qui naissait en eux de clair, de prosaïquement efficace et d’ordonné. » [44]
Conclusion
L’intérêt des réflexions de Georges Bataille sur l’art préhistorique et surtout les fresques pariétales est particulièrement vif lorsqu’on s’attache à la question des rapports entre création et chaos. Le premier élément qu’il fait intervenir dans le devenir humain des hominiens est l’outil. C’est lui qui permit aux hominiens de devenir des Homo faber : d’une certaine façon, l’on peut dire des Homo faber ce que Hegel disait des Grecs [45], à savoir qu’ils ont aménagé le cosmos à notre intention. Mais de façon symptomatique, l’hominisation ne fait pas plus de l’être humain un être transparent à lui-même que l’Esprit Absolu ne se manifeste dans la philosophie de Hegel. Il demeure un impensé qui fait que l’art n’est pas ancilla philosophiae, mais vaut pour lui-même comme manifestation de forces violemment à l’œuvre en l’homme.
Cette violence qui sourd dans l’art pariétal au moment où l’homme se rend compte de la part animale qu’il détient et, d’une certaine façon, de l’état paradisiaque qu’il quitte pour un monde de création technique durable où sa destinée personnelle est d’être happé par le chaos, cette violence transgresse et crée cependant. Bataille ne fut pas sans remarquer que les mêmes impulsions étaient à l’œuvre dans la peinture moderne (Picasso) : processus de décomposition et de destruction de la figure humaine qui témoigne d’une aspiration au ‘tout autre’. En un temps où les superstructures impérieuses du monde créé par le travail menaçaient de tout étouffer, et parce qu’il cache et révèle en même temps, « le masque est le chaos devenu chair » [46].
Voir en ligne une visite virtuelle de la Grotte de Lascaux.
Lire en ligne un article sur La dimension sonore des grottes ornées par Iégor Reznikoff et Michel Dauvois ou le télécharger ici :

